Nous vous conterons ici, en quelques lignes bien sûr trop brèves, l’extraordinaire épopée des quatre frères Bielski et de leur camp de partisans. Trouvant refuge, dès l’été 1941, dans d’épaisses forêts, ils y montèrent peu à peu un camp de maquisards, qui abrita au bout du compte jusqu’à plus de mille deux cents personnes de tous âges.
Leur aventure s’inscrit, dans l’histoire tragique de la Shoah, comme la plus grande entreprise de résistance et de sauvetage menée par des Juifs pour sauver d’autres Juifs.
L’opération Barbarossa
Le 22 juin 1941, les troupes allemandes se lancent dans une immense et violente attaque contre l’URSS. Cette opération est nommée Barbarossa, en hommage à l’empereur Frédéric Barberousse. Les communautés du Yiddishland, s’étirant des États baltes au nord jusqu’en Ukraine et la Crimée au sud, constituent l’une des principales cibles des troupes nazies : cinq grandes « unités spéciales » (Einsatzgruppen), formées à cet effet, sont chargées de massacrer le plus grand nombre possible de Juifs et de parquer les autres dans des ghettos. On estime à environ 1 million 750 mille le chiffre effrayant de victimes juives, en moins d’un an. C’est la période que l’on nomme maintenant la « Shoah par balles ».
Les Juifs des centaines de ghettos créés dans les vastes territoires conquis durant cette « guerre éclair » sont soumis à de dures privations et au travail forcé, en attendant leur déportation. Certains tentent de se cacher, comptant parfois sur les liens d’amitié noués avant-guerre avec des paysans polonais ou biélorusses, mais les déceptions sont fréquentes, cruelles et amères ; d’autres, en petit nombre, parviennent à prendre la fuite vers la jungle des forêts de Biélorussie. Mais comment se nourrir et subsister dans cet univers hostile et inconnu, qui plus est dans le froid rigoureux de l’hiver ? Comment échapper aux paysans des environs, qui souvent dénoncent les fugitifs aux Allemands, par haine antijuive ou par peur de représailles à leur encontre ? Quelques maquis de résistants commencent certes à se former et à lutter contre l’occupant nazi, mais leurs membres sont souvent, eux aussi, hostiles aux Juifs : ils refusent fréquemment de les prendre dans leurs rangs ou les massacrent tout simplement.
Les frères Bielski
De petits maquis de fugitifs juifs parvinrent certes à se former ici ou là, mais peu parvinrent à subsister. Celui de Touvia Bielski et de ses frères fut alors l’une des rares exceptions, et la plus importante d’entre elles. Qui donc étaient-ils ?
Il y avait l’aîné, Touvia (1906-1987), le chef incontesté, doué d’un charisme singulier. Ancien sergent de l’armée polonaise, il possédait, outre sa connaissance des armes, une autorité naturelle et une grande force de volonté. On admirait son calme et sa maîtrise de soi en toutes circonstances, sa capacité à manifester de l’empathie et à inspirer confiance. Pour lui, la menace vitale qui pesait sur son peuple imposait une attitude claire dont, malgré certaines oppositions, il ne se départit jamais : « Mieux vaut sauver une vieille femme juive que tuer dix nazis. » Telle était sa devise, qu’il répétait comme un mantra.
Il y avait ensuite Alexander, surnommé Zous (1912-1995). Zous était le guerrier vaillant et intrépide, prêt à mener des raids risqués, et c’est lui qui dirigeait les opérations militaires du camp. Sa bravoure et son désir d’apporter protection là où il le pouvait en firent un élément essentiel de la survie du camp.
Il y avait aussi Assaël (1908-1944), que son esprit rigoureux et planificateur imposa comme responsable de la gestion quotidienne, dans un camp qui allait sans cesse en grandissant. Recruté en 1944 par les forces soviétiques, il tomba au combat face aux Allemands.
Il y avait enfin Aharon, surnommé Artchik, né en 1927, qui coule encore une vieillesse paisible en Floride, sous le nom d’Aron Bell. Son dynamisme et son agilité en faisaient l’homme des missions spéciales : faire des repérages dans les villages environnants, repérer des fugitifs et les conduire au camp ; s’infiltrer au sein des ghettos les mieux gardés, y donner ou y récolter des nouvelles, informer leurs habitants des possibilités de fuite vers les forêts, afin de rejoindre le « camp Bielski ».
Le camp
Dès les débuts de l’occupation allemande, Touvia et ses trois frères refusèrent de se laisser enfermer dans un ghetto. Originaires de la petite localité de Stankiewicze, où leur famille possédait un moulin, ils virent avec douleur leurs parents enfermés dans le ghetto de Nowogródek, avec leurs six frères et deux sœurs : ils allaient être assassinés par les nazis. Accompagnés de quelques parents et amis, ils gagnèrent la profonde forêt de Naliboki, où ils établirent un camp de fortune. Suivant les fermes instructions de Touvia, ce camp devint au fur et à mesure le refuge privilégié des Juifs des environs qui parvenaient à fuir les ghettos : contrairement à une certaine logique – observée ailleurs – qui aurait voulu qu’on n’y accepte que des jeunes en bonne santé et, si possible, munis d’armes et de munitions, on y accueillait jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants même en bas âge, quel que soit leur état de santé. C’était, en bref, un camp où des familles entières purent retrouver un semblant de normalité, y compris dans l’observance religieuse. Touvia était en effet intimement convaincu que telle était l’urgence du moment et l’impératif moral qui s’imposait à eux.
Le camp, comprenant à sa plus grande extension plusieurs unités secondaires, comportait des abris rudimentaires en bois ou creusés dans le sol, des cuisines, un hôpital de fortune, une école et des ateliers divers (couture, cordonnerie, réparation d’armes…). Ses habitants, en fonction de leur âge et de leur état de santé, se répartissaient en deux grands groupes : ceux qui assumaient les tâches quotidiennes de l’entretien du camp et ceux qui montaient la garde, effectuaient des rondes ou partaient dans des opérations de guérilla. Il fallait en effet veiller aux menées allemandes dans les environs, cherchant à faire disparaître ce camp de partisans juifs dont la réputation s’était répandue aux alentours ; mais il fallait aussi se protéger des paysans polonais ou biélorusses hostiles, et même d’autres maquis voisins, soumis aux autorités soviétiques, où la haine des Juifs n’était pas rare.
Les opérations à l’extérieur
Les opérations extérieures répondaient à plusieurs impératifs : tout d’abord, le ravitaillement. Les partisans du camp partaient régulièrement en expédition dans les fermes de la région pour se faire livrer, de plus ou moins bon gré évidemment, des provisions ou même du bétail. Les paysans, même quand ils n’étaient pas hostiles, souffraient eux-mêmes des réquisitions allemandes ou d’autres maquisards qui n’hésitaient pas à les maltraiter. Les partisans de Bielski connurent dans ces expéditions de nombreux et douloureux échecs et des trahisons inattendues ; mais ils bénéficièrent aussi, plus souvent qu’on ne pourrait le croire, de l’aide de paysans biélorusses compatissants, sachant pourtant qu’ils risquaient leurs vies et celles de leurs familles en portant la moindre assistance à ces Juifs.
Il y avait également des opérations de sabotage d’infrastructures diverses ou l’attaque de convois allemands. Ces opérations allèrent en se renforçant tout au long de la guerre, au fur et à mesure de l’avancée des troupes soviétiques et de la coordination obligatoire avec les autres maquis.
Mais il y avait aussi, et peut-être surtout, les tentatives répétées d’organiser la fuite du plus grand nombre de Juifs des ghettos. Opérations complexes, dangereuses, supposant de bout en bout une soigneuse préparation. Voici le récit impressionnant d’une scène qui se déroula en mai 1943, alors qu’un groupe de Juifs avait réussi à s’échapper du ghetto de Lida. Transis de peur et épuisés (ils s’étaient arrêtés pour donner un peu de repos à des jeunes gens portant leur grand-père sur leur dos), ils se trouvaient comme hébétés dans une petite clairière, lorsqu’un appel étrange retentit : « Debout tout le monde ! Mettez-vous en rang et restez en silence ! » Ils virent alors s’avancer un groupe d’une quinzaine d’hommes en armes, venus les accueillir pour les conduire par de longs chemins vers la forêt de Nabiloki. Les quatre frères étaient là, Touvia à leur tête, le port humble malgré son allure militaire. Il voulait s’adresser à eux, mais sa voix tremblait d’émotion et ses yeux brillaient de larmes. Il finit par leur dire en russe :
Camarades ! Ce jour est le plus beau jour de ma vie, car j’ai mérité de voir un groupe aussi important que le vôtre s’enfuir enfin du ghetto ! (…) Je ne vous promets rien, et nous pouvons très bien être tués tout en cherchant à rester en vie. Mais nous ferons tout pour sauver le maximum de vies. C’est cela la voie que nous avons choisie : nous ne faisons aucun tri, aucune sélection, nous n’éliminons ni les vieux, ni les enfants, ni les femmes. Notre vie est dure, le danger nous menace à chaque instant, mais si nous périssons, si la mort nous atteint, nous mourrons comme des êtres humains ! »
Au lendemain de la guerre
Ces hommes et ces femmes éprouvés connurent, comme des centaines de milliers de Juifs rescapés des camps, des ghettos ou de la déportation par les Russes en Sibérie, le retour difficile à la vie, dans un monde dévasté. Ces hommes et ces femmes très « ordinaires » se virent célébrés comme des héros de la résistance à l’oppression et du sauvetage de leurs frères face à l’extermination. Leur camp hors normes, qui abritait des combattants désireux d’en découdre avec l’ennemi, au même titre que des familles dans la plus grande fragilité, fut montré en exemple. Certains osèrent, en Pologne comme en Biélorussie, les accuser de pillages à l’encontre de pauvres paysans désarmés. Mais eux ne songèrent en aucune circonstance à tirer gloire de ce qui, de leur point de vue, n’avait été que l’accomplissement de leur devoir comme Juifs, et comme êtres humains tout simplement.
Touvia et Artchik affrontèrent de nouveaux combats en Erets Israël, durant la guerre d’indépendance de 1948. Touvia ne demanda, par la suite, rien de plus qu’un emploi comme chauffeur de taxi. Mais tous deux finirent, durant les années cinquante, par rejoindre leur frère Zous aux États-Unis. On a beaucoup écrit à leur sujet (voir notamment le très beau livre en anglais de Nechama Tec, Defiance, The Bielski Partisans). Leur histoire a même fait l’objet d’un film qui a connu un certain succès, malgré diverses critiques. Interrogé, Aron Bell aurait répondu laconiquement : « Au moins, ils n’ont pas déformé nos noms. »

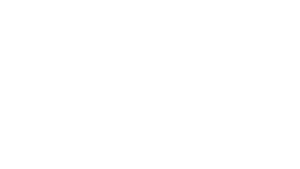




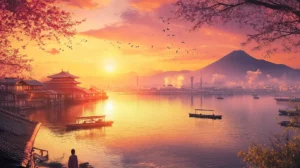








Une réponse
Emouvant