Pour le peuple juif, New York, surnommée « The Big Apple », s’est révélée être une terre d’asile providentielle, telle une somptueuse pomme généreusement enrobée d’un miel exquis, offrant à la fois la douceur d’un refuge et la promesse d’une vie nouvelle riche en opportunités. Selon les données les plus récentes, New York abrite la plus grande communauté juive en dehors d’Israël, avec environ 1,6 à 2 millions de Juifs, soit plus de trois fois le nombre de Juifs français! Cette population représente environ 8,8% de la population totale de New York. Concentrés à l’origine dans l’historique Lower East Side, point de chute de nombreux immigrants juifs, ceux-ci se sont désormais dispersés dans de nombreux quartiers. On les retrouve dans de vastes communautés à Brooklyn, comme à Crown Heights, quartier général du mouvement loubavitch, ou à Williamsburg, un des plus grands centres de la communauté juive orthodoxe aux États-Unis, ou encore à Borough Park. Des communautés juives sont également présentes dans le Bronx et le Queens, bien qu’en moindre proportion. Enfin, la communauté juive de New York étant très diverse, allant des Juifs ultra-orthodoxes aux Juifs non pratiquants, en passant par les communautés réformées et conservatrices, on retrouve cette diversité dans la variété des quartiers juifs de la ville.
Les Juifs participent activement à la vie économique et culturelle de la mégalopole et ont une part essentielle dans son influence mondiale. Il suffit de se rappeler les trois maires juifs de New York (Abe Beame, Ed Koch et Michael , à ne pas confondre avec les trois mères juives de Woody Allen) pour percevoir le lien intime qui relie le peuple juif à l’histoire de la ville qui ne dort jamais.
Les premiers Juifs du Nouveau Continent
Mais cette lune de miel a une longue histoire, et pour être tout à fait honnête, les débuts ont été quelque peu difficiles. C’est grâce à leur patience active et industrieuse, ainsi qu’à à leur rare ténacité que les Juifs font intimement partie de l’histoire de New York : ils ont su s’y tailler une place dans le rêve américain, à l’ombre des gratte-ciel de la Skyline.
Tout commence en 1524 avec les débuts de la conquête de l’Amérique : Giovanni de Verrazano ( dont l’un des célèbres ponts de la ville porte fièrement le nom), florentin et capitaine du bateau français La Pensée, découvre la baie de New York, et nomme l’endroit Angoulême, en l’honneur du roi de France, François Ier. En 1609, l’île de Manhattan sera découverte par Henry Hudson, qui y abordera sur le Half Moon, et remontera ensuite la rivière du Nord qui portera le nom de « Hudson River ». Le Mayflower accoste en 1620 à Cape Code, y déposant les premiers colons sur le sol américain.
Mais les Juifs font déjà partie intégrante de la conquête du nouveau continent : il y a Christophe Colomb, bien sûr, dont l’origine juive vient d’être enfin confirmée par des examens génétiques ; c’est lui qui a découvert les Bahamas et prouve l’existence d’un continent inconnu des Européens ; mais il y a surtout Luis de Carabajal y Cueva , un converso (c’est à dire un marrane), conquistador espagnol qui met le pied au Texas en 1570. Il sera suivi par Joachim Gans en 1584, puis en 1621 par Elias Legardo, Juif séfarade venant du Languedoc, qui s’installe à James City, en Virginie. Il avait été appelé afin d’enseigner aux colons comment cultiver des vignes pour la vinification. En 1624, les premiers colons hollandais s’installent dans l’île de Manhattan et fondent Fort Orange (future Albany) et la ville de la Nouvelle Amsterdam ( future New York). Pierre Minuit achète l’île de Manhattan aux Indiens pour la somme surréaliste de 60 guilders, soit 24 dollars. L’année suivante, le montant global des exportations de la colonie s’élèvent déjà à plus de 56 mille guilders.
En parallèle, la guerre entre la Hollande et le Portugal fait rage au Brésil. En 1630, les forces hollandaises conquièrent la ville de Recife. Sous leur nouveau régime plus tolérant à leur
égard, les Juifs qui avaient échappé à la terrifiante Inquisition portugaise, ou qui s’étaient convertis de force, reviennent ouvertement à la foi de leurs ancêtres. Mais pour leur plus grand malheur, le 25 Janvier 1654, Recife retombe dans les mains de l’armée portugaise du général Barretto. Le retour en force de l’Inquisition sera impitoyable. Les Juifs qui sont retournés à leur foi sont dénoncés, retrouvés et brûlés en autodafé. Ceux qui ne s’étaient pas convertis sont expulsés.
Le 26 février 1654, vingt-trois Juifs se trouvent à bord du navire hollandais le Valck. Ces pauvres gens ont, pour la plupart, tout perdu car, suite à l’inventaire de leurs biens par les Portugais, ils avaient été payés en “bois du Brésil », un bois précieux utilisé pour la teinture. Mais, au dernier moment, ce bois avait été en grande partie jeté à la mer, à cause du nombre excessif de passagers hollandais au départ du bateau.
Les premiers Juifs de New York
Le 4 septembre 1654, après un voyage éprouvant et un séjour dans les prisons de la Jamaïque, les vingt-trois premiers Juifs de New York foulent enfin la grève de l’Hudson. Ils y sont accueillis par Jacob Barsimson, voyageur Juif hollandais qui s’y trouvait de passage.
Leur installation est difficile. Ils sont poursuivis en justice par le capitaine du St Charles (ou de la Sainte Catherine, le bateau ayant changé de nom pour des motifs troubles et malhonnêtes), un corsaire français du nom de Jacques de la Motthe : le Valk ayant été arraisonné puis coulé par les Espagnols, les passagers ont dû payer un nouveau droit de passage sur son navire. Les Juifs, ruinés, n’ont plus les moyens de régler le solde de leur voyage, deux fois supérieur à celui des autres passagers, et doivent attendre qu’une aide leur arrive des Pays-Bas, ce qui prendra plusieurs mois.
Le gouverneur de la Nouvelle Amsterdam, Peter Stuyvesant, voit lui aussi d’un mauvais oeil, l’arrivée de Juifs dans son fief et s’en plaint directement à Amsterdam. Il les considère comme des miséreux mais surtout comme une menace pour la toute puissance locale de l’Eglise réformée calviniste hollandaise. Son secrétaire, Van Tienhoven est un antisémite déclaré, qui tentera même de faire expulser les Juifs de la Nouvelle Amsterdam, ce que son supérieur refusera.
Il y a, malgré tout, de bonnes âmes comme Solomon LaChair, un avocat qui les aide à défendre leurs droits, ou comme le révérend Polheymius, qui a fait le voyage avec eux depuis Recife, qui a apprécié leur courage et qui les aidera à faire face aux premières difficultés en participant à leur intégration.
Les multiples tracasseries administratives et autres discriminations, comme l’interdiction de monter la garde de la cité mais l’obligation de payer une taxe comme ceux qui ne souhaitent pas y prendre part, ne parviennent pas à triompher de la détermination et de la pugnacité des Juifs, qui voient leurs rangs s’élargir avec l’arrivée de nouvelles familles.
Le pluralisme religieux, profondément ancré dans les traditions néerlandaises, combiné au fait que les Juifs font partie des plus gros actionnaires de la Compagnie, poussent les hauts dirigeants de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, siégeant à Amsterdam, à désavouer la position du gouverneur Stuyvesant et à lui imposer une attitude plus tolérante.
En 1656, les Juifs obtiendront l’attribution d’un cimetière pour enterrer les leurs. En février 1657, Asher Levy van Swellem, l’un des vingt-trois premiers immigrants et leader de la communauté, obtiendra officiellement les petits droits de cité de la ville puis l’autorisation de monter la garde.
Les Juifs obtiennent progressivement le droit d’exercer diverses professions. Les métiers de boulanger, menuisier, pottier leur étaient à l’origine inaccessibles, les cantonnant à la vente au détail, ce qui les prive de participer au négoce des peaux de castor, premier grand
produit commercial local. Ils acquièrent deux îlots de terrain pour y établir une synagogue mais la construction leur en sera interdite.
La Nouvelle Amsterdam devient New York
Le coup de théâtre arrive le 28 Août 1664, lorsque la flotte britannique s’ancre au large de la Nouvelle Amsterdam et en demande la reddition. La population, se refusant à se battre contre des forces qu’elle pense supérieures, s’oppose au gouverneur Stuyvesant et refuse de résister. Suite à la capitulation, la ville s’appelle désormais New York, en l’honneur du duc d’York, dont le fort Amsterdam, devenu Fort James porte le nom.
En 1673, en l’absence du Gouverneur Lovelace, les Hollandais reprennent la ville, mais le 19 février 1674, le traité de Westminster marque la fin de la guerre anglo- néerlandaise et met fin à la présence hollandaise sur le continent nord-américain en attribuant définitivement les nouveaux Pays-Bas à la Grande-Bretagne.
L’attitude anglaise est plus tolérante envers les Juifs : conformément aux instructions britanniques sur la liberté de culte, la communauté juive de New York, vingt ans après l’arrivée de ses premiers membres, se réunit officiellement pour la première fois à la fin de l’année 1674 pour une cérémonie religieuse dans une synagogue qu’ils nommeront Cheérith Israël (les survivants d’Israël). La première synagogue, qui portera d’ailleurs ce nom, sera érigée en 1729 sur Mill Street. Le bâtiment est accompagné d’un mikvé (bain rituel), connecté à une source voisine. Les rescapés de l’Inquisition portugaise établissent la première communauté juive, première de beaucoup d’autres, dans une ville à laquelle ils ont et vont encore beaucoup donner.
Certains deviendront des acteurs importants du commerce du sucre avec les Caraïbes, d’autres développeront le commerce de détail, tous participant à l’essor de la ville naissante.
Les Juifs prennent activement part à la Révolution et à la Guerre d’Indépendance américaine, où certains se hissent même à des postes de responsabilité. Au terme de ce conflit, ils obtiendront enfin la pleine citoyenneté américaine.
Les premiers Juifs et la statue de la Liberté
La mémoire des vingt-trois premiers Juifs de New York se verra évoquée sur l’un des symboles les plus célèbres de la ville: la Statue de la Liberté. A son pied, un poème intitulé “Le nouveau colosse” rédigé par Emma Lazarus, descendante de Juifs portugais, transmet aux futures générations l’espoir de ses ancêtres:
“ Donne-moi tes pauvres, tes exténués,
Tes masses innombrables aspirant à vivre libres,
Le rebus de tes rivages surpeuplés,
Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte
Je dresse ma lumière au-dessus de la porte d’or !”
Vision juive de l’Exil
La Kabbale juive offre une interprétation profonde de l’Exil : au-delà de sa dimension historique, il serait une quête mystique visant à rassembler les étincelles de sainteté dispersées dans le monde, préparant ainsi la venue du Messie. Dans cette optique, la présence tardive mais significative des Juifs dans le Nouveau Monde peut prendre une dimension fascinante. Cette concentration remarquable sur des terres lointaines pourrait être vue comme une accélération inattendue de ce processus spirituel, transformant l’Exil en un catalyseur de la rédemption finale, et tissant un lien subtil entre géographie, histoire et mystique kabbalistique.

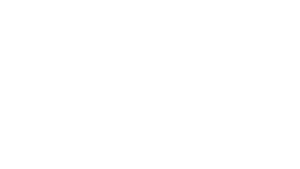





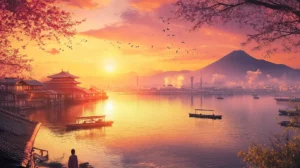







Une réponse
J’ai lu pour une vraie histoire émouvante et touchante
Je vous souhaite une bonne continuation à la volonté d Hashem qu’on découvre toujours de toutes sortes des histoires y compris à la Torah…
Amen ve amen 🌸