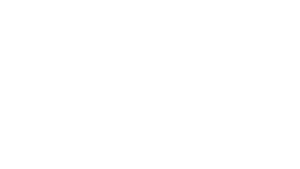Rappelons pour mémoire que l’Inquisition ne s’est jamais attaquée aux Juifs en tant que tels, mais uniquement à ceux qui, convertis, se seraient rendus coupables de « judaïser » en secret, au mépris de leur « engagement » catholique. Ceux qui n’avaient jamais cessé de pratiquer leur religion n’étaient pas inquiétés. De ce point de vue, les enfants des conversos étaient tout particulièrement à plaindre, car ils étaient nés dans la religion catholique sans qu’on leur ait jamais demandé leur avis, et devaient naviguer dans une étrange double vie entre ce que la société environnante leur avait inculqué dès leur naissance, et un profond attachement, également inculqué dès leur naissance par leurs parents, à une religion dont ils ignoraient presque tout et qui était une menace pour leur vie.
Doña Gracia
C’est dans ce contexte que naquit Gracia Nassi, baptisée sous le nom de Beatriz De Luna, dans une famille fortunée de conversos. C’est ainsi que dès sa naissance, celle qui allait devenir la Señora, la Dame, s’est trouvée marquée par les trois éléments qui feraient la trame de toute sa vie : une identité inconfortable doublée du désir ardent de revenir à son peuple, l’argent qui tel une épée à double tranchant était à la fois la plus grande des menaces et le plus grand instrument de secours, et un tempérament aussi indomptable que généreux.
Elle fut mariée très jeune à son oncle, Francisco Mendes (de son nom juif Tsema’h Benveniste), nettement plus âgé qu’elle, à la fois banquier influent et beaucoup plus riche qu’elle encore. Sa fortune provenait principalement du commerce des épices (importation du poivre depuis l’Inde et exportation de diverses matières premières), des pierres précieuses et des textiles européens. Il possédait de plus tout un réseau de banques qui avaient des agents et des branches dans toute l’Europe, notamment à Lisbonne, Anvers, Londres et Venise, ce qui le rendait influent dans les affaires économiques de son époque. Il prêtait même de l’argent aux rois, à commencer par celui du Portugal. C’est presque certainement lui qui a formé sa femme aux méandres du commerce et de la banque, dont elle a manifesté plus tard une grande maîtrise.
Veuve et riche banquière
Mais il meurt prématurément en 1535, et c’est elle qui va se trouver désormais à la tête d’une immense fortune, qu’elle va gérer habilement. De ce fait, elle ne tarde pas à se trouver dans une situation périlleuse : une jeune veuve richissime ne peut manquer d’attirer l’attention de prétendants aussi puissants qu’indésirables, et elle sent rapidement qu’elle ne va pas pouvoir plus longtemps les repousser sans attirer l’attention, et qu’il est impératif de quitter le Portugal. Sous prétexte d’un voyage touristique en Angleterre, laissant sur place tous ses avoirs locaux et emmenant avec elle sa fille unique Ana (Reyna de son nom juif), sa jeune sœur Brianda et ses deux neveux Joseph et João Micas (Mendes), elle se dirige alors vers Anvers, où l’Inquisition n’était pas encore instaurée et qui était un grand centre commercial où les conversos jouissaient d’une relative tolérance, et où de plus son beau-frère Diogo Mendes administrait une partie des biens familiaux.
Dans le milieu des conversos, les mariages plus ou moins consanguins étaient fréquents, à la fois dans un souci de préserver le patrimoine familial et d’avoir la certitude de mariages juifs. Ainsi, après avoir épousé son oncle, Gracia mariera sa sœur Brianda au frère de ce dernier, qui se trouvait donc être à la fois son oncle et son beau-frère, et plus tard elle donnera sa fille en mariage à son neveu Joseph Nassi. Certains pensent que de plus, la fille de Brianda, nommée elle aussi Gracia, aurait épousé João, frère de Joseph, mais il n’en existe pas de preuve formelle.
Bien qu’Anvers ait été relativement plus souple que l’Espagne et le Portugal envers les conversos, la plus grande prudence y demeurait de rigueur, et si Gracia Nassi y a commencé à renouer avec les pratiques juives, ce qu’elle a toujours désiré ardemment, ce ne pouvait encore être qu’en secret. Mais c’est là qu’elle a commencé à se consacrer à l’aide de ses frères conversos, principalement en créant des filières de fuite vers des pays plus cléments, notamment Venise et l’Empire ottoman, activité qu’elle développera plus tard dans de plus amples proportions, et qui rappelle un peu l’Aliah Bet (immigration clandestine vers la Palestine), et la Beri’ha au terme de la Shoah (plus de deux cent mille Juifs fuient l’Europe de l’Est à la libération des camps nazis, pour gagner les ports français et italiens et, de là, entrer clandestinement en Erets Israël).
Parallèlement, elle gérait avec habileté les banques appartenant en commun à son mari et à son beau-frère Diogo, et celui-ci, sans s’y tromper, lui donnait une place d’importance dans ses transactions financières, pour lesquelles, par ailleurs, son épouse Brianda ne manifestait aucun intérêt.
Pérégrinations
C’est pourquoi, lorsque lui aussi décéda prématurément en 1543, il avait légué par testament la plus grande partie de sa fortune à sa belle-sœur plutôt qu’à sa femme, sachant qu’elle était plus à même de la gérer et qu’elle en ferait meilleur usage. Gracia Nassi se retrouva donc seule à la tête de la puissante banque Mendes et de l’immense réseau commercial de la famille, ce qui ne serait pas sans lui causer bien des ennuis par la suite.
Presque immédiatement, le sol d’Anvers commença à être en effet trop chaud pour qu’elle puisse s’y attarder. Charles Quint (petit-fils d’Isabelle la Catholique) projetait de faire venir l’Inquisition aux Pays-Bas espagnols (dont Anvers faisait partie), et Gracia commençait à être soupçonnée de judaïser en secret. De plus, le même Charles Quint s’était mis à lorgner avec convoitise la fortune des Mendes, dont il avait bien besoin pour financer ses guerres et son immense empire, et il méditait de s’en emparer soit par un mariage opportun soit tout simplement par une accusation de judaïsation, accompagnée automatiquement de la confiscation des biens.
Ayant donc fui Anvers, elle s’installe d’abord à Venise vers 1545. Mais la paix n’était pas encore au programme. Sa sœur Brianda, qui n’avait aucune envie de la suivre dans ses pérégrinations, que son catholicisme ne dérangeait apparemment pas beaucoup, et qui était habituée à une vie de luxe, contesta le testament de son mari en s’appuyant sur les tribunaux chrétiens d’Anvers, ce qui ne pouvait manquer d’attirer l’attention et la suspicion sur sa sœur. Certains l’ont accusée de l’avoir dénoncée comme judaïsante, mais cela paraît tout de même peu probable, étant donné les conséquences dramatiques qu’une telle démarche aurait pu avoir. Quoi qu’il en soit, sous prétexte qu’elle devait rendre des comptes sur la gestion de l’héritage Mendes, les autorités vénitiennes l’ont emprisonnée pendant deux ans. Elle a fini par être libérée grâce au paiement de lourdes sommes, l’abandon d’une partie de ses biens à Brianda et l’habile intervention de son neveu Joseph Nassi. En 1552, elle quitta Venise pour Ferrare.
Là, le duc Ercole II d’Este lui offrait une protection plus stable. Ferrare était alors un refuge pour les Juifs et les conversos fuyant l’Inquisition, ce qui convenait mieux à ses ambitions de soutien aux communautés juives. À peine arrivée, elle s’est mise derechef à chercher des moyens de soutenir les conversos, en leur facilitant l’installation à Ferrare où régnait une certaine liberté religieuse, et en leur permettant de retrouver une pratique de la religion juive. C’est également là qu’elle a financé la publication de plusieurs ouvrages en hébreu et en espagnol qui leur était destinés. Elle a surtout contribué à publier, en 1553, la Bible de Ferrare, une traduction de la Bible en ladino, traduite par Yom Tov Atias (un converso revenu au judaïsme connu sous le nom de Jerónimo de Vargas) et révisée par Abraham Usque, qui est restée une référence pour les communautés séfarades.
Mais son but ultime était de se rendre dans l’Empire ottoman. En 1553, environ un an plus tard, Gracia quitte Ferrare pour Constantinople (via Ancône), où elle trouvera enfin un refuge stable sous la protection du sultan Soliman le Magnifique, et où elle pourra désormais vivre ouvertement son judaïsme.
La Señora
C’est là où, dans la force de l’âge et s’épanouissant dans sa liberté religieuse enfin retrouvée, elle va devenir « la Señora », la Dame par excellence, surnom à la fois honorifique et affectueux qui lui a été attribué par toutes les communautés juives qu’elle aidait à travers l’Europe et l’Empire ottoman et qui la voyaient comme une protectrice. De plus, Soliman le Magnifique lui octroya le titre de « Señora de la Casa Mendes » (Dame de la Maison Mendes).
Dès son arrivée, elle met sa fortune au service de la cause qui lui tenait le plus à cœur : le soutien à apporter dans toutes sortes de domaines aux conversos désireux de pouvoir vivre en paix dans la religion de leurs pères. Elle finance leur passage vers l’Empire ottoman, les aide à s’installer, crée des synagogues et des écoles, on lui attribue même la fondation d’une yechiva et d’un hôpital juif. Elle favorise également le développement du quartier juif de Constantinople.
Elle est rejointe peu après 1554 par son neveu Joseph Nassi, devenu entre-temps son gendre, et qui va rapidement monter en influence à la cour ottomane grâce à ses talents diplomatiques et économiques, au point d’être nommé duc de Naxos par le Sultan. Il sera désormais et jusqu’à sa mort son plus proche collaborateur.
Le blocus d’Ancône
En parallèle à son travail à Constantinople, un autre épisode marquant, qui témoigne de son courage et de sa détermination, s’est déroulé dans le port d’Ancône, ville portuaire des États pontificaux, dont l’importante communauté juive comptait de nombreux conversos. Gracia avait passé un accord avec le Pape Jules III, moyennant finances bien évidemment, au terme duquel ces derniers avaient l’assurance qu’ils ne seraient pas inquiétés. Cependant, après sa mort, son successeur, le très hostile Paul IV, annula cet accord et lança une répression brutale contre les conversos : en 1556, vingt-quatre d’entre eux furent brûlés vifs, malgré les protestations de la communauté juive et les tentatives d’intervention de Gracia.
Celle-ci, furieuse, décida ni plus ni moins de se venger du Pape, en imposant un blocus au port d’Ancône, dans l’intention de le ruiner. Malheureusement, les marchands juifs eux-mêmes avaient des intérêts trop importants à Ancône, sans compter qu’ils avaient tout lieu de craindre des représailles sanglantes, et le blocus fut un échec. Toutefois, il reste l’un des premiers exemples historiques de résistance économique organisée contre une persécution (et de surcroît initié par une femme).
Reconstruire Tibériade
Mais audacieuse et visionnaire, c’est à une autre entreprise qu’elle consacra les dernières années de sa vie. L’empire ottoman était certes une terre d’accueil, mais elle voulut infiniment plus pour tous les Juifs chassés d’Espagne et du Portugal, qui voulaient pratiquer leur religion librement et sans dépendre de qui que ce soit. Or qu’envisager de mieux à cet effet que la Terre sainte, qui se trouvait alors sous domination ottomane ? Elle essaya d’abord d’obtenir de Soliman le Magnifique, vers 1561, des droits sur Jérusalem, mais ils lui furent refusés. Elle se tourna alors vers Tibériade, le deuxième centre religieux le plus important dans l’histoire d’Israël, qui était alors en ruines et auquel le sultan n’attachait guère d’importance.
Joseph Nassi, son neveu et gendre, acquit en son nom des droits sur la ville moyennant une sorte de loyer annuel, payé naturellement par Gracia. En quelque sorte, on peut dire qu’ils « achetèrent » la ville. D’un projet commun et grâce à ce qui restait de l’argent de la Señora, ils entreprirent de la reconstruire et d’en faire un centre économique juif autonome, ce que le sultan ne voyait d’ailleurs pas d’un mauvais œil, car le développement de la région était susceptible de consolider la présence ottomane face aux menaces vénitiennes et portugaises.
Les efforts pour réhabiliter la ville furent réels, mais si elle s’est senti une dette de reconnaissance envers Gracia au point de lui consacrer un musée, il ne semble toutefois pas que celle-ci y ait vécu personnellement, étant déjà âgée pour l’époque et usée par les voyages et les tribulations. De plus, elle se sentait plus utile à Constantinople. Les archives de la ville ne font mention que de l’activité de Joseph Nassi, bien entendu encouragé et financé par elle. Il entreprit la reconstruction des remparts pour sécuriser les lieux, ce qui était une condition essentielle à la stabilité d’une implantation durable. Il chercha à développer l’agriculture et le commerce de la soie, un secteur économique prometteur qui devait permettre à la communauté de subsister. Il encouragea également l’arrivée de Juifs, notamment ceux qui avaient été récemment expulsés d’Europe, en leur offrant des avantages pour s’installer.
Toutefois, ces efforts ne produisirent pas les résultats escomptés. La ville resta faiblement peuplée, et les initiatives économiques ne suffirent pas à assurer une prospérité durable. Il semble que les conditions historiques n’étaient pas encore réunies pour en faire un mouvement de grande ampleur. Peu de Juifs se sont sentis attirés par des conditions de vie difficiles, alors que la vie communautaire était déjà bien établie dans l’empire ottoman. De plus, ils étaient épuisés par leurs épreuves et ne se sentaient pas une vocation de pionniers, sans parler de la grande insécurité qui sévissait à l’époque dans cette région régulièrement attaquée par des bandes de pillards de toutes origines. Sans compter qu’après la mort de Soliman le Magnifique, protecteur de Joseph Nassi, le pouvoir de ce dernier se mit à décliner. La Señora elle-même quitta ce monde en 1569 à Constantinople, ce qui laissait ce projet, visionnaire ô combien, doublement orphelin.
Nos Sages enseignent que l’épreuve de la richesse est plus redoutable que celle de la pauvreté. À une époque troublée où survivre était la préoccupation essentielle de ses contemporains, la Señora fait partie de tous ceux qui, à travers l’Histoire, ont magnifiquement surmonté cette épreuve. Elle l’a fait avec intelligence et cœur, au péril de sa vie. Que son souvenir soit source de bénédiction.